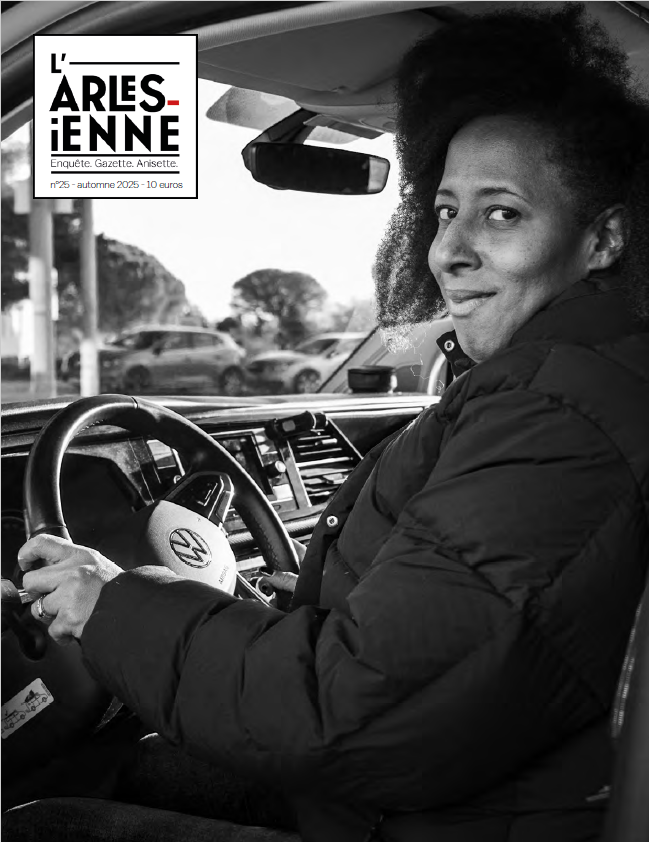« On a reporté la dette sur les hôpitaux »

Pierre-André Juven est sociologue, chargé de recherche au CNRS rattaché au centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société. Il a récemment coécrit avec Frédéric Pierru et Fanny Vincent La casse du siècle, à propos des réformes de l’hôpital public, aux éditions Raison d’Agir.
Depuis l’adoption de la tarification à l’acte au milieu des années 2000, qui finance les hôpitaux ?
La question, c’est qui gouverne l’hôpital. Dans les faits, le financeur principal c’est l’Assurance maladie. Une grande partie des budgets est consacrée à la tarification à l’activité, une autre partie est composée des enveloppes de missions d’intérêt général, qui sont soumises à variation, à fluctuation. Les hôpitaux sont un peu fébriles à propos de ces enveloppes. Même si, en théorie, elles doivent leur donner un peu plus de souplesse, car il y a une intervention directe de l’État sur l’attribution des enveloppes. Parfois, en fin d’exercice, quand il se rend compte que le niveau des dépenses hospitalières excédera ce qui avait été prévu en début d’année, il arrive à l’État de ne pas les distribuer. Et pour des hôpitaux qui avaient budgété leurs dépenses, arrivés en fin d’année, ça peut contribuer à la création d’un déficit. C’est toujours le piège quand l’Etat et l’Assurance maladie disent : « Nous sommes à l’équilibre, on a respecté l’objectif national des dépenses. » On a juste reporté la dette sur les structures hospitalières, qui sont obligées, elles, de prendre en charge des gens. Et dans les années 2000, la dette des hôpitaux a explosé.
Qui fixe les tarifs des actes ?
C’est l’agence technique pour l’information hospitalière. Ils sont fixés sur la base de mécanismes compliqués. Il y a des études de coûts conduites annuellement pour connaître le prix moyen des prises en charge, avec énormément de controverses sur la façon de calculer et sur toutes les failles en terme de statistique. A partir du coût moyen, les pouvoirs publics décident d’attribuer un tarif, et parfois de les diminuer notamment, pour tenir les dépenses de l’Assurance maladie. Une fois que vous avez les tarifs de tous les séjours, vous faites une estimation de l’année à venir sur l’ensemble du territoire et vous dites : l’activité multipliée par les tarifs, ça va nous donner une enveloppe de, disons, 40 milliards. Mais si on s’est donné un budget de 35, on opère une diminution sur les tarifs pour rentrer dans ces 35 milliards. Et c’est ce qui fait que les hôpitaux ne comprennent pas du tout le fonctionnement des financements.
Avec la tarification à l’acte (T2A), est-ce qu’on s’oriente petit à petit vers une privatisation de la santé ? C’est caricatural de le voir comme ça ?
La T2A a deux objectifs à la base. D’abord, orienter l’activité médicale. Elle a vocation notamment à promouvoir la chirurgie ambulatoire, pour diminuer les dépenses hospitalières. Et ça, c’est sa deuxième vocation : contrôler les dépenses en modulant les tarifs en fonction des objectifs d’activité. Il n’y a pas forcément l’objectif de privatiser une partie des dépenses de santé. Toutefois, dans les faits, c’est ce qu’il se passe. La chirurgie ambulatoire est un très bon exemple. Vous entrez à l’hôpital, vous sortez le soir. Alors attention, quelquefois ça se justifie, hein, sur le plan médical, sur le plan personnel. Mais parfois les gens rentrent chez eux après des prises en charge lourdes. Et là où l’hôpital prenait en charge la surveillance la nuit qui suit l’opération avec un personnel médical dédié, c’est reporté sur les personnes elles-mêmes, voire sur des personnels de santé qui viendront vérifier. En général, c’est pris en charge par l’Assurance maladie, mais pas tout le temps : tout d’un coup, vous déboursez de votre poche, ou votre mutuelle, mais c’est la même chose : ce n’est plus une dépense collectivisée, c’est une dépense privée. Mais ce n’est pas tant la T2A qui fait la privatisation des dépenses de santé, c’est la diminution du rythme d’augmentation des moyens. Les moyens augmentent de toute façon, parce que la population augmente, à cause de l’inflation, du vieillissement de la population. Mais comparativement à ce que l’activité supposerait, les dépenses diminuent.
Si les moyens manquent, les patients auront de moins en moins confiance dans l’hôpital public ?
La T2A tend à créer des activités rentables et d’autres qui ne le sont pas. Si vos coûts de production sont inférieurs aux tarifs, vous gagnez de l’argent. Si vous êtes une clinique, vous vous spécialisez là-dedans, vous faites des bénéfices, vous investissez, vous avez un personnel joyeux, etc… Donc les gens se disent : « C’est plutôt là qu’il faut aller ». Mais alors, vous laissez à l’hôpital public tous les autres types de prises en charge, ceux qui ne sont pas rentables parce que les tarifs ne prennent pas en compte tout un tas d’éléments, notamment la diversité des populations à soigner. Ce qu’on appelle aussi les polypathologies, le fait qu’un patient ait plusieurs pathologies et qu’au moment où vous le traitez vous prenez en charge tout ce qu’il a par ailleurs. C’est là qu’existe un déséquilibre. Le privé peut sélectionner, ne pratiquer que des accouchements sans complication, des opérations de la cataracte et des prothèses de hanches. L’hôpital public ne peut pas. Il doit aussi s’occuper des cirrhoses du foie avec des patients SDF qui par ailleurs consomment de la drogue. C’est beaucoup moins rentable. On donne plus de latitude au privé et surtout on enfonce le public.
Alors le rapprochement avec le secteur privé c’est la conclusion logique de ces choix de gestion ?
Dès le moment où vous fragilisez des structures publiques, vous ouvrez le champ à un marché. Les fermetures de lit, c’est ce qui se fait à l’échelle nationale pour développer plus d’ambulatoire. Le problème, c’est que tous les médecins et tous les spécialistes du système de santé disent que ce n’est pas parce que vous prenez en ambulatoire que vous diminuez la file active par ailleurs, à savoir les gens qui attendent pour être opérés, hospitalisés. Ce n’est pas parce que vous fermez des lits qu’il y a moins de besoin. C’est une vraie illusion de technocrates de penser que les gens vont se faire soigner parce qu’il y a des lits ouverts. Il y a au niveau national un décalage énorme entre l’ouverture des lits en ambulatoire et la fermeture de lits en hospitalisation classique. Et le problème c’est que les besoins médicaux rattrapent les plans gestionnaires et qu’il y a de vrais besoins de lits. Mais pour des hôpitaux exsangues, rentrés dans des spirales négatives, très endettés, qui ont parfois contracté des emprunts toxiques, où il y a de plus en plus d’interim – et l’interim ça coûte plus cher que le recrutement pérenne – il n’y a aucun moyen pour réinvestir dans des lits. Lits qui permettent, au passage, de désengorger les urgences, de faire monter les patients dans les étages.
Propos recueillis par Nicolas Puig
Dossier à lire dans l’Arlésienne n°7 :
Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.
Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !