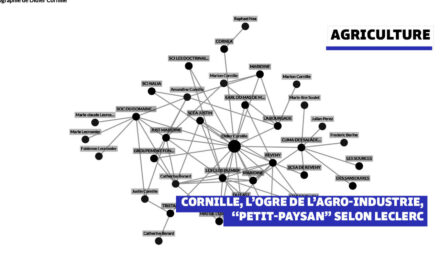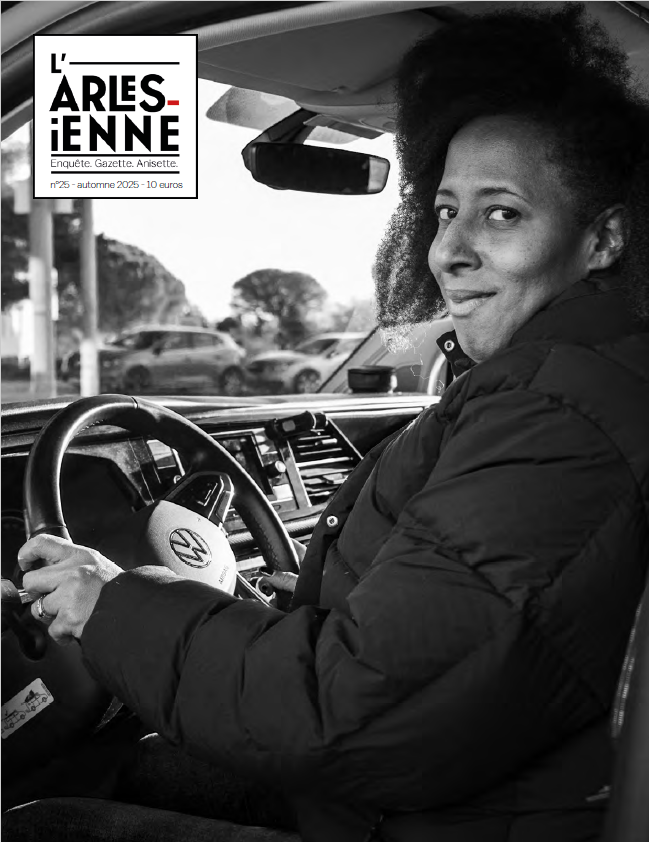Hôpital : le feu au lac

Des urgences en grève perlée depuis le mois d’avril, un personnel soignant pressurisé, une direction qui doit composer avec un déficit chronique, une politique nationale qui demande toujours plus d’efforts et une perspective de rapprochement avec le privé à court terme. Comme beaucoup d’autres en France, l’hôpital d’Arles vacille. Malgré l’épuisement, les équipes sont mues par une motivation quasi militante.
Ils sont en blouse blanche, allongés sur le parvis des arènes. Aides-soignants, infirmiers, brancardiers, personnel administratif. Un médecin aussi. Des Arlésiens, sur la musique de Gladiator (eh, ici, tout est épique), montent lentement les marches pour les relever. On aperçoit le raseteur Joachim Cadenas, les gérants du restaurant du Paty, des rugbymen, des citoyens, des syndicalistes, le conseiller municipal et candidat à la mairie Nicolas Koukas, le comique Anthony Joubert… Voilà la vidéo que les urgentistes d’Arles ont postée sur internet à la fin du mois de septembre. La métaphore est évidente mais on n’est pas là pour faire dans la dentelle. Le service est en grève perlée depuis le mois d’avril. Pas d’arrêt de travail pour le personnel, qui serait dans tous les cas réquisitionné. Alors il faut faire passer le message, de toutes les façons possibles, via des vidéos, des banderoles à l’entrée de l’hôpital et des messages dans la salle d’attente des urgences.
Partout en France, ça hurle dans les hôpitaux. Des dizaines de services d’urgences sont en grève depuis le printemps. Résultat d’années de ras-le-bol chez les paramédicaux, qu’ils soient brancardiers, aides-soignants ou infirmiers, parfois rejoints par des médecins. Et comme dans de nombreux autres établissements, c’est la question de la sécurité qui a mis le feu au lac de l’hôpital Joseph Imbert. Jérémy Chanchou, aide-soignant récemment syndiqué à Force Ouvrière le rappelle : « Moi j’ai fait huit ans de nuit. On va pas dire que la violence est quotidienne, mais elle est récurrente. » En novembre par exemple, un patient avait blessé trois membres du personnel. L’équipe a donc demandé la présence d’un vigile 24h sur 24. L’hôpital a élargi sa présence à la nuit, mais pas encore à la journée entière.
Surtout, cette colère en a réveillé d’autres, latentes depuis longtemps. « On est fatigués, on est épuisés. Au niveau des équipes, heureusement qu’il y a une bonne ambiance entre nous. Sinon ce serait très dur. Mais épuisement, c’est le mot », décrit Yann Maes, aide-soignant aux urgences de nuit depuis quatre ans. Yann Maes est aussi syndiqué Sud. Mais il rappelle : « C’est le service qui a rejoint le collectif Inter-urgences. Pas les syndicats. »
Gestion à flux tendu
La question des effectifs n’a pas tardé à devenir centrale dans les revendications des urgentistes. Les urgences d’Arles accueillent en moyenne 100 personnes par jour. Mais il y a des pics, en hiver au moment des épidémies, en été lors de la profusion touristique. L’affluence, que Jérémy Chanchou estime généralement à « 60 % le jour et 40 % la nuit » n’est cependant jamais prévisible. « Il y a des nuits où on fait autant d’entrées que la journée, avec un tiers d’effectif en moins, relate Yann Maes. Nous, le soir, on démarre à 19h, on arrive direct dans le rush qui a commencé vers 17h30. A 19h, il y a trois médecins, trois aides-soignants, trois infirmiers. A 21h, l’équipe de brancardiers et les secrétaires quittent les urgences. C’est les aides-soignants qui les remplacent. Il n’y a pas non plus de personnel pour descendre à la morgue, c’est aussi alloué aux aides-soignants. A noter que la journée c’est des équipes de trois personnes aux radios. La nuit, il est tout seul. Il fait radio et scan. Les gens râlent, mais le manip’ radio est tout seul. Et ça prend du temps. » Jérémy Chanchou insiste : « On a eu deux arrêts maladies de filles qui se sont fait mal en brancardant. Il va falloir finir par reconnaître qu’il faut de l’aide. » C’est pourquoi le personnel mobilisé demande l’ouverture de deux postes de nuit : un brancardier et un administratif. Mais la direction de l’hôpital n’a pas bougé pour l’instant. Et pour les urgentistes, ces problèmes concernent tout l’hôpital : « Les urgences, c’est l’arbre qui cache la forêt, ce qu’on veut c’est que tous les services se rallient à la grève. Il faut du personnel en plus pour tout le monde. »
« Ils ont gardé l’effectif de ces dernières années, mais l’affluence a augmenté », fait aussi remarquer Jérémy Chanchou. Pourquoi cette hausse ? « C’est un tout, selon Yann Maes. Les médecins de ville ne peuvent pas recevoir plus de patients pendant la journée. Et la nuit, il n’y a pas de médecin. Alors les patients vont soit en maison médicale, soit aux urgences. Il n’y a pas de SOS médecin à Arles. » Mais pour le personnel, il y a une autre raison : les nombreuses fermetures de lits ces dernières années. L’arrêt des fermetures de lits, c’est d’ailleurs une des trois grandes revendications nationales des urgences en grève, avec une hausse de 300 euros des salaires et 10 000 emplois supplémentaires. Annie Bastié, secrétaire du syndicat FO pour l’hôpital d’Arles, fait le compte : « Dernièrement ils ont fermé 15 lits de chirurgie, 21 ou 22 lits de médecine, mais ils te disent qu’ils les ont transformés… Moi j’ai connu l’hôpital avec deux services de 30 lits à chaque étage ! »
Or, Yann Maes le rappelle : « Les urgences, c’est la tête de pont. De là découlent beaucoup d’hospitalisations. » Alors s’il manque des lits dans les services des étages, ça bouchonne dans les couloirs des urgences. « A cause des fermetures, il nous est arrivé de garder quelqu’un sur un brancard toute la nuit, en attendant qu’un lit se libère dans la journée, conclut-il, dénonçant cette gestion à flux tendu. Il y a quasiment une aile fermée sur tout l’hôpital. »

« L’hôpital s’effondre par manque d’effectif. Je souhaite travailler longtemps dans le public. Si on ne le fait pas, tout va s’écrouler. J’ai vu des services entiers fermer par simple manque de médecin », s’engage Michael Bernardi.
Le virage ambulatoire
Le bureau de Pascal Darthoux, directeur des ressources humaines de l’hôpital, est tout blanc. Pas de décoration. Le soleil passe par la fenêtre. L’air est calme et le discours serein. Patricia Champel, ancienne infirmière désormais directrice des soins de l’hôpital, pleine d’énergie, tempère : « Des gens sur des brancards pendant des heures ce n’est pas notre quotidien. On est encore à taille humaine. » Le sous-effectif dans le service ? Pour le DRH, ce n’est pas vraiment ça le problème : « Le flux est variable, ce n’est pas programmé. » Il n’évoque pas la demande de deux postes supplémentaires la nuit. Puis, lui et la directrice des soins font visiter à l’Arlésienne une aile du septième étage en cours de rénovation. Des travaux financés par l’Agence régionale de santé (ARS). L’étage accueillera d’ici peu le service de gastro-entérologie, situé un étage en dessous, qui vit toujours dans ses locaux d’origine, made in 1974. Le dernier service à ne pas avoir été réhabilité. Ça sent la peinture, ça perce et ponce dans les futures chambres des patients. Ces dernières seront équipées de douches, contrairement à celles de l’ancien service.
On en profite pour parler de la diminution du nombre de lits dans l’hôpital. Combien ont été fermés ces dernières années ? La direction préfère rester évasive sur le sujet. Ce qui est clair, c’est l’explication de Patricia Champel : « Avant, pour une prothèse de hanche, vous restiez quinze jours sans bouger. Maintenant, vous sortez le lendemain. La médecine évolue, et c’est mieux pour le patient. La position allongée entraîne des risques de phlébite, d’escarres… Plus vite vous vous levez, plus ces risques diminuent. » Dans le jargon médical, c’est ce qu’on a appelé le «virage ambulatoire». « Moins les gens restent à l’hôpital, mieux c’est pour eux ! », conclut Pascal Darthoux, le DRH. Alors, les progrès de la médecine désengorgent-ils l’hôpital ?
Ce n’est peut-être pas si simple. Le développement de l’ambulatoire, en particulier pour la chirurgie, est très encouragé par l’Etat et donc par l’ARS, son bras armé dans les régions. Notamment depuis l’adoption dans le milieu des années 2000 de la tarification à l’activité (T2A), plus proche du système de financement pratiqué par les établissements privés. Auparavant, les hôpitaux bénéficiaient d’une dotation globale de financement forfaitaire. Depuis la T2A, leur financement est calculé selon l’activité générée par les actes médicaux qui y sont pratiqués, actes qui sont ensuite payés à l’hôpital par l’assurance maladie. La valeur de chaque acte étant fixée nationalement chaque année, et soumise à variation . Pour rentrer dans son budget, il peut arriver à l’Etat de diminuer le prix de certains actes très pratiqués (lire nos interviews du directeur de l’hôpital et d’un sociologue). S’il n’y a pas d’acte, il n’y a pas de financement. Pour l’hôpital, il est plus rentable de ne prendre les patients que le temps de l’acte médical. Fini le temps de l’accompagnement, avant ou après acte.
Un petit pas vers le privé
Résultat, les petits hôpitaux, pratiquant moins d’actes que les gros, ont pâti de cette réforme. A l’équilibre et même excédentaire avant la T2A selon son directeur Laurent Donadille (lire ici), l’hôpital d’Arles est devenu mécaniquement déficitaire après son adoption, comme beaucoup d’autres. Cumulant environ trois millions d’euros de déficit par an, soit 20 millions d’euros de déficit cumulé. Il doit désormais faire la preuve de « l’efficience » de sa gestion auprès de l’Agence régionale de santé, qui l’aide en contrepartie de ses efforts, à financer les investissements nécessaires à son développement comme à sa survie. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre Patricia Champel quand elle explique : « Pour calculer notre capacité en lits, on s’appuie sur les statistiques de fonctionnement. On avait des taux d’occupation à moins de 80 % dans les services. Sur un plan médico-économique, ce n’était pas efficient. »
De la fenêtre du septième étage, on contemple le paysage : le lac, l’Ehpad, le centre de dialyse privé. Ce dernier était situé sur le site de la clinique Jeanne d’Arc jusqu’en 2015, année du déménagement sur le site de l’hôpital. Ça nous rappelle un projet : le futur GCS, comprenez Groupement de coopération sanitaire. Il s’agit d’un rapprochement avec les cliniques Paoli et Jeanne d’Arc, propriétés du groupe Elsan, fragiles économiquement, comme l’hôpital. L’idée : créer un seul pôle sur le site de Joseph Imbert, regroupant l’offre de santé à Arles. Dès l’an prochain, le service de cardiologie de la clinique Paoli déménagera à l’hôpital. Soit 27 lits. Il sera entièrement public : la capacité en lits de l’hôpital augmentera donc significativement. Puis, à l’horizon 2022, les activités de la clinique Jeanne d’Arc rejoindront l’hôpital, qui aura bénéficié pour l’occasion de travaux de modernisation en partie financés par l’ARS : le bloc opératoire sera agrandi, de même que l’unité de chirurgie ambulatoire, le laboratoire de biologie médicale sera reconstruit, ainsi que les unités de réanimation et de surveillance continue. Une maison de consultations devrait aussi être créée. Le budget de ces travaux devrait tutoyer les 15 à 17 millions d’euros. L’utilisation de ces équipements publics par le privé se traduirait par le versement d’une redevance à l’hôpital. « Si ce projet arrive, c’est aussi qu’on a la place pour l’intégrer, note Patricia Champel. Ce sera bien pour les Arlésiens, il y aura tout sur place. » Du privé où il y avait autrefois du public.

Sophie Alibert, cheffe de service gastro-entérologie travaille dans le public par choix. « Maintenant, en réunion de direction, la seule chose qui compte, c’est l’activité, avant on parlait de prise en charge des patients. » Photo E.B.
Pénuries
Mais ça, c’est le futur, même s’il est proche. Au sixième étage, il y a le service de gastro-entérologie du présent. Vingt lits. Et son PC infirmiers, salle de contrôle du service, entouré de vitres, où les soignants et aides-soignants, entre les visites dans les chambres, travaillent. Cet après-midi il y a deux infirmiers, deux aides-soignants, deux médecins, un agent de surface hospitalier. Effectif normal.
Marc Olive est enjoué, sa voix est douce, rassurante. Et son propos lucide. Il est infirmier, avec pas mal de bouteille : « On passe presque 50 % de notre temps sur l’ordinateur. » Bien sûr, il relativise : « Les conditions matérielles aujourd’hui, par rapport à avant, c’est le jour et la nuit. On a tout ce qu’il faut pour bien travailler. » Mais Marc Olive donne un exemple de ce que ça donne, l’efficience médico-économique, dans le réel : « On est passés de 8h à 7h30 de travail par jour. On a une demi-heure de moins, mais la quantité de travail n’a pas diminué. On a des gens dans des lits. Ils sont malades. Alors on déborde, on part plus tard. » Cette demi-heure a été rognée sur les relèves du matin et du soir, désormais réduites à un quart d’heure. La relève, c’est le moment où les équipes changent, et où chacun donne les informations nécessaires au suivi des patients. Et si le temps de travail diminue sur la journée, il ne diminue pas sur l’année : alors une demi-heure de plus par jour, ça fait 13 jours de plus à l’hôpital.
Michael Bernardi, lui, est FFI, faisant fonction d’interne en médecine générale. Il est jeune médecin mais n’a pas encore passé sa thèse. Il travaille dans le service aux côtés de trois gastro-entérologues et veut faire sa carrière dans le public, par conviction : « Je gagne pas des mille et des cents avec mon statut, mais l’hôpital public s’effondre. Par manque d’effectif. Il manque un médecin par service. Mais pas seulement Arles, il manque des médecins dans tous les hôpitaux. » Et ce, à cause de l’austérité budgétaire ambiante. « Les directions serrent les boulons. Si la rémunération augmentait, ils auraient moins de difficultés à recruter. » Sophie Alibert, la cheffe de service, prend le relais, assise derrière son ordinateur : « On travaille dans le public par choix aujourd’hui. On a des mails tous les deux jours pour nous proposer de nous installer dans le privé. 45 % des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus en France. C’est une pénurie organisée. Dans les années 1990, il y avait trop de médecins. Et les autorités se sont dites : plus de médecins, c’est plus d’actes. Donc, ça coûte plus cher. Ils ont favorisé les départs en retraite et diminué le numerus clausus du concours d’entrée en médecine. Maintenant, le système se casse la figure. » Et pour remédier à ce manque quand il devient trop urgent, l’hôpital a recours à des médecins intérimaires. Mieux rémunérés que les praticiens hospitaliers sur la durée de leur courte mission. Aux urgences, leur passage est très fréquent. Pour l’ARS, c’est un exemple d’efficience médico-économique négative.
Défense du service public
Et un cercle vicieux qui s’enclenche. Un service qui manque de médecins, c’est un service où le travail sera plus lourd. « En 2000 quand je suis arrivée ici, on était six à prendre nos astreintes, se souvient Sophie Alibert. Et on avait moins de 60 ans ! Maintenant on est quatre, dont deux qui ont 70 ans. L’hôpital public c’est comme ça, ça ne tient qu’à un fil. » Et non seulement ça n’attire pas les jeunes praticiens, mais ça épuise aussi ceux qui sont déjà en poste : « Je comprends qu’à l’échelle nationale les moyens manquent, mais nous on tiendra pas. On voit des situations difficiles, des soins palliatifs, des cancers avancés, on peut faire des semaines de 60h, travailler huit à onze jours d’affilée, être appelés trois fois dans la nuit, et il faut être souriants le matin. On n’a pas le droit de se plaindre, c’est le patient qui se plaint. »
La nouvelle politique de la santé arrivée avec la T2A a mis a rude épreuve les équipes. La cheffe de service Sophie Alibert remarque que « les objectifs augmentent, mais pas les moyens ». Elle remarque aussi que le contenu des réunions avec la direction a changé. « Il n’y a que l’activité, la quantité, la rentabilité qui comptent. On doit donner des explications sur nos baisses d’activité. On nous dit qu’il y a des choses rentables et que c’est elles qu’il faut réaliser. Avant, on parlait d’organisation générale et de la prise en charge des patients. » Pourtant, malgré toutes ces entraves, les hospitaliers travaillent dur pour garder à flot leurs services. Ils en sont remerciés, parfois, par les malades : une lettre de gratitude de la famille d’un patient du service est affichée, dans la salle de repos. « Si on reste là, c’est qu’on a envie que le système fonctionne », continue la cheffe de service.
Alors se rapprocher du privé pour redonner un souffle à l’hôpital, et accroître son attractivité auprès des médecins ? Tout le monde y croit, mais chacun reste sur ses gardes. Pour Michael Bernardi, le jeune médecin, « c’est très bien, aujourd’hui on est confronté à une menace réelle : la fermeture de l’hôpital. Comment faire avec des dettes, des coûts d’entretien importants, des services qui coûtent mais ne rapportent pas ? » Sophie Alibert non plus n’est pas opposée à l’idée : « Travailler ensemble, pourquoi pas ? Mais le partage reste à faire. Si c’est que le week-end commence le vendredi à 14h30 pour le privé, ou alors qu’ils nous disent « ce patient ne va pas bien tu me le prends », ça n’ira pas. » Et le risque que le privé accapare les actes qui rapportent et laisse au public les moins rentables (lire notre entretien) ? Un praticien de l’hôpital nous prend par le bras, dans un coin, et nous souffle à l’oreille : « On n’a pas vocation à faire ce que le privé ne veut pas faire. La santé est devenue un marché. Nous, on est un service public. C’est ça qu’il faut défendre. Moi, j’ai quelqu’un dans le lit, je le soigne. Je lui demande pas sa carte. On a un bel outil. C’est à nous de nous battre. » Mais se battre contre qui ? Contre la direction ? Encore un mot à l’oreille : « Le directeur il est comme nous. Il applique les directives. Alors ici, je travaille. Dehors, je vote. »
Nicolas Puig avec Eric Besatti
Dossier à lire dans l’Arlésienne n°7 :
Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.
Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !