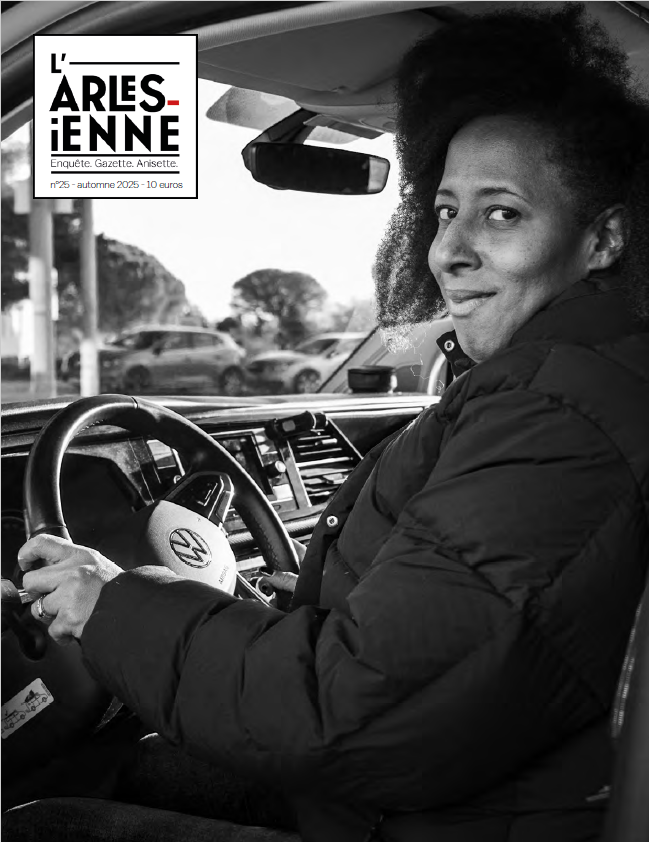Laurent Donadille : « il faut montrer à l’ARS notre efficience médico-économique »

Laurent Donadille est directeur de l’hôpital d’Arles depuis 2013, après en avoir été le directeur adjoint de 2001 à 2006. Entre un déficit chronique, des difficultés à recruter des médecins et un climat national plutôt porté sur les économies budgétaires, il doit faire tourner la machine.
Comment devient-on directeur d’hôpital ?
On passe un concours à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), à Rennes, où sont formés tous les directeurs d’hôpital de France. La plupart des étudiants ont suivi des formations surtout autour de Sciences po et veulent passer des concours de la fonction publique, l’ENA, l’Ecole nationale de la magistrature. L’EHESP n’est pas forcément la plus connue. C’est le fruit du hasard en ce qui me concerne, l’intervenant à la préparation ENA que je suivais à Aix-en-Provence était directeur de l’hôpital d’Aix. Il nous a parlé de ce métier, qui est effectivement très original, avec un sentiment d’autonomie, puisque vous gérez un budget, des projets, le développement de l’offre de soins, et de responsabilité.
Alors vous êtes aixois ?
Marseillais ! Nobody is perfect… Mais mes études se sont déroulées à Aix. On choisit ce métier par sens de l’Etat alors ? C’est pas tant l’Etat, c’est faire en sorte qu’un hôpital public puisse proposer à une population l’offre de soins la plus proche possible des besoins. Donc il faut adapter nos plateaux techniques, nos disciplines médicales, pour que la population ait à proximité un hôpital public qui réponde à cela, en complémentarité avec les autres établissements du territoire. C’est un travail quotidien, maintenir l’hôpital malgré des difficultés, puisqu’il est en déficit. On a plus de dépenses que de recettes, mais malgré tout on se bat pour maintenir l’offre de soins.
L’exercice en tant que directeur, c’est convaincre l’Agence régionale de santé (ARS) au quotidien ?
Il faut montrer à l’ARS que l’hôpital est capable de se réorganiser, de se rénover, de se restructurer pour maintenir une activité, avec, c’est le terme consacré, une « efficience médico-économique » suffisante pour justifier notre présence ici, à Arles. La recherche de l’efficience médico-économique s’est accentuée parce que l’hôpital public a subi une révolution au milieu des années 2000, quand on est passé à la tarification à l’activité (T2A, ndlr) : tout séjour hospitalier génère des ressources et si on n’a pas d’activité, on n’a pas de recettes. C’est quelque part comme toute entreprise, même si l’hôpital n’est pas une entreprise, mais le modèle économique est le même. Pendant longtemps, jusqu’au milieu des années 2000, l’hôpital était financé sur un budget global, quelle que soit l’activité. Donc je caricature, mais moins l’hôpital avait d’activité, moins il avait de dépenses, mieux c’était pour son budget, qui était respecté. C’est ce mécanisme qui a fait que les pouvoirs publics, à juste titre, ont dit qu’il fallait accompagner le financement des hôpitaux par le financement de l’activité. Ce qu’effectuait déjà le secteur privé parce que c’est dans ses gènes, la rémunération à l’activité. Donc on a raisonné, là aussi c’est peut-être un terme économique qui nous rapproche du secteur commercial, en parts de marché. En disant nous, hôpital public, on se devait de regagner des parts de marché et de proposer des activités supplémentaires. Alors c’est vrai qu’en France on est allé assez loin puisqu’on est allé quasiment sur du 100 % de financement à l’activité sauf quelques missions de service public comme la santé des détenus, la permanence des soins pour les plus démunis, la psychiatrie…
Donc vous, vous avez vu ce changement de logique ?
Je l’ai vu ! L’hôpital d’Arles, de par sa nature architecturale, avait été doté de moyens assez conséquents. Avant la T2A, il était à l’équilibre, il était même excédentaire, mais l’activité n’était pas énorme. Et quand on a basculé sur le financement à l’activité, il y a eu un gap puisque l’activité rémunérée sur la base de tarifs nationaux ne nous a pas permis d’équilibrer nos dépenses. Parce qu’on était organisés sur un ancien modèle. Et le bâtiment a des frais de structure. On est « immeuble de grande hauteur », ce qui nécessite des mises aux normes en terme de sécurité incendie, une équipe d’une trentaine de personnes, 24h sur 24, 365 jours sur 365. On est aussi inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tout ça, ce n’est pas financé par la tarification à l’activité. Bout à bout, l’hôpital s’est retrouvé en difficulté, avec la nécessité, pour compenser, de toujours travailler un peu plus, avec en plus une politique nationale qui faisait que chaque année les tarifs diminuaient, donc c’est toujours travailler un peu plus pour espérer avoir les budgets correspondants.
A combien s’élève le déficit de l’hôpital ?
On est autour de trois millions d’euros chaque année, mais en étant accompagnés en trésorerie par l’ARS. En déficit comptable cumulé, on doit être à un peu plus de 20 millions d’euros. Ce n’est pas rien à l’échelle de l’hôpital. Le budget total est de l’ordre de 100 millions d’euros. Il devait être de l’ordre de 75 millions d’euros, ce qui montre que depuis 15 ans, il y a eu une progression non négligeable des recettes et dépenses. Le personnel représente 70 % de la dépense du budget principal. Malgré les efforts, les réorganisations, l’activité supplémentaire que ceci a pu générer, la situation budgétaire de l’hôpital ne s’est pas améliorée. Les règles du jeu ont été telles qu’année après année on s’est retrouvé avec un déficit structurel lié à la conception du bâtiment et à l’activité, qui n’était pas suffisante pour faire face à l’ensemble des dépenses. On a dû, ces dernières années, réduire en matière d’investissements, alors même que l’hôpital a besoin d’investissements. Comme toute structure, un hôpital qui n’investit pas meurt, les médecins ont besoin d’équipements neufs, les personnels de mobilier adapté.
A Joseph Imbert, il a fallu supprimer des postes ?
Non, il a fallu garder notre effectif dans un premier temps, puis s’organiser pour avoir un peu plus d’activité. Ensuite, l’idée c’était effectivement d’adapter nos effectifs et nos organisations de travail. On a fait effectivement peut-être un peu plus d’efforts sur les fonctions logistiques, supports, administratives. Mais on a maintenu un nombre d’emplois tout à fait satisfaisant. Et on a gardé à peu près les mêmes effectifs par service de soin. Par contre ce qu’on a un peu revu, c’était les cycles de travail et les organisations dans ces services.
La question du manque de personnel est quand même centrale pour les gens qui travaillent ici, qui commencent à être très fatigués…
Notre organisation est comparable à celle des autres hôpitaux. On est accompagné par une agence qui s’appelle l’Agence nationale d’appui à la performance. Elle communique des indicateurs pour estimer que sur telle ou telle activité, tel nombre de passages aux urgences, tel nombre de séjours hospitaliers, tant d’interventions au bloc opératoire, vous devez travailler a priori de telle ou telle façon. Pour ce qui est des médecins, ce n’est pas facile d’en recruter. Il manque au minimum trois urgentistes, des psychiatres… Tout cumulé, ça doit donner une bonne dizaine de médecins que je suis prêt à rémunérer malgré notre déficit parce que c’est eux qui nous permettent de maintenir notre offre de soins et notre activité. C’est un cycle infernal, moins vous avez de médecins moins vous avez d’activité, moins vous avez de recettes, moins vous pouvez recruter. Il faut éviter ça. Après je suis très clair, quand je suis arrivé ici, on avait des cycles de travail un peu datés. Ce qui nous a été demandé par l’ARS, c’était de revoir nos organisations pour qu’avec à peu près le même personnel, je l’avoue, on puisse travailler un peu plus. Et effectivement, aujourd’hui, le constat un peu partagé c’est que la plupart des hôpitaux publics se sont beaucoup réorganisés, ont fait beaucoup d’efforts sans forcément une pleine amélioration des résultats économiques. Voilà pourquoi la situation est un peu difficile. Les urgences en sont un exemple.
Votre marge de manœuvre semble extrêmement réduite. Comment ça se passe avec l’ARS ?
Ça se fait en bonne intelligence ! L’ARS nous accompagne, mais à nous de les convaincre. Par exemple on vient de répondre à un appel à projet sur la psychiatrie. On veut renforcer notre équipe ado parce qu’on sait que la santé des adolescents est quelque chose de plus en plus complexe. Donc on a un centre d’accueil pour adolescents qui est en ville, mais on veut le renforcer en créant une équipe mobile qui ira sur tout le territoire. Avec les moyens actuels de l’hôpital je ne peux pas la développer. Donc on répond à un appel à projets. Si notre projet est jugé satisfaisant et si l’ARS voit qu’à côté de ça on s’est déjà réorganisés, qu’on a déjà fait des efforts, ils vont nous donner des moyens pour faire face à des besoins supplémentaires.
Le virage ambulatoire est dû à l’évolution des soins, de la prise en charge, mais aussi au besoin de rentabilité ?
Si le séjour est quantifié et valorisé pour que ce soit un séjour ambulatoire et que le patient reste deux, trois, quatre jours, tous les soins et les dépenses supplémentaire ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. Donc ce sera un séjour qui coûtera plus cher à l’hôpital que ce qu’il lui aura rapporté. Il y a bien sûr des cas où ce séjour un peu exceptionnel, un peu plus long, peut être justifié. Et il ne faut pas parler de rentabilité. Moi je n’ai pas d’actionnaires, contrairement aux groupes privés. Le seul actionnaire de l’hôpital c’est le patient. Par contre il faut que le budget soit équilibré. Malheureusement on n’y est pas encore.
N’est-ce pas à cause de ces restrictions de moyens que l’hôpital a mauvaise réputation ?
Je m’en désole de cette réputation ! Il y a un engagement de tous pour promouvoir cet établissement. On reçoit aussi des lettres de remerciements ! Mais le bouche à oreille est tel que parfois une mauvaise expérience fait tache d’huile. Aujourd’hui, à tort ou à raison, on peut penser qu’on sera mieux pris en charge dans une grande structure, un CHU ou un centre privé. Je pense que ce n’est pas toujours le cas.
Après, il y a les compétences médicales rares. Il est normal aussi que pour une intervention chirurgicale, on prenne un avis, peut-être un deuxième. C’est à nous de convaincre y compris la médecine de ville, avec qui on a conforté nos relations. C’est pour ça que j’essaie de faire en sorte, en toute modestie, qu’on parle plutôt en bien de l’hôpital. Surtout aujourd’hui il y a les réseaux sociaux, chacun met des avis, comme au restaurant. Si ce n’est que l’avis, en matière de santé, ça nécessite d’être objectif.
Depuis quand existe le projet de groupement de coopération sanitaire , de rapprochement avec les cliniques ?
On travaille avec le groupe Elsan (propriétaire des cliniques Jeanne d’Arc et Paoli, ndlr) et l’ARS sur différents scenarii de rapprochement public privé depuis un an et demi deux ans. Sachant qu’il faut que ce soit gagnant-gagnant.
Ça ne peut pas être au détriment de l’un ou de l’autre. Il était hors de question pour l’hôpital d’abandonner telle ou telle activité. Et il fallait que le secteur privé continue à vivre sur Arles. C’est un peu une nouveauté de faire en sorte qu’entre public et privé on puisse travailler ensemble. J’y crois. Et c’est favorisé par l’ARS. Il va y avoir un service d’hospitalisation complète en chirurgie, une unité d’anesthésie ambulatoire privée comme il y en aura une unité publique, on partagera le bloc. Ces projets sont de nature à remuscler l’hôpital, à réoccuper certains étages. Ça va redonner une vie supplémentaire, y compris pour la production des repas, le traitement du linge, tout ce qui va avec.
Le privé fera ce qui rapporte ? Le reste sera pour le public ?
On n’a pas vocation à ne faire que des opérations qui ne rapportent pas ! Il y a des hôpitaux qui sont à l’équilibre oui, c’est possible, je reconnais que c’est rare mais c’est possible. On n’est pas là pour être rentables, mais pour être à l’équilibre, pour nous dégager des marges de manœuvres pour continuer à investir. Et j’ai des chirurgiens qui n’ont rien à envier à ceux du secteur privé, chacun travaille bien ! Il peut y avoir de l’émulation plutôt que de la concurrence. Il y a matière à porter un projet médical commun qu’il faut construire, et c’est aux médecins de le faire eux-mêmes, pour qu’ensemble ils proposent à la population du pays d’Arles la meilleure offre de soins. Si on part de ce modèle un peu caricatural qui oppose public et privé on n’y arrivera pas. On a des missions de service public qui nous sont propres, on a des surcoûts, qu’on assume, il appartient aux pouvoirs publics de les accompagner.
Propos recueillis par Eric Besatti et Nicolas Puig
Dossier à lire dans l’Arlésienne n°7 :
Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.
Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !