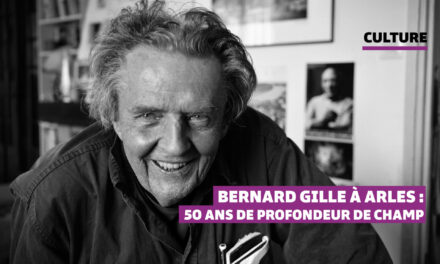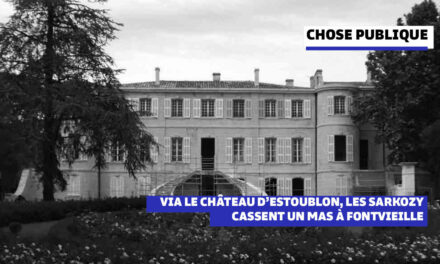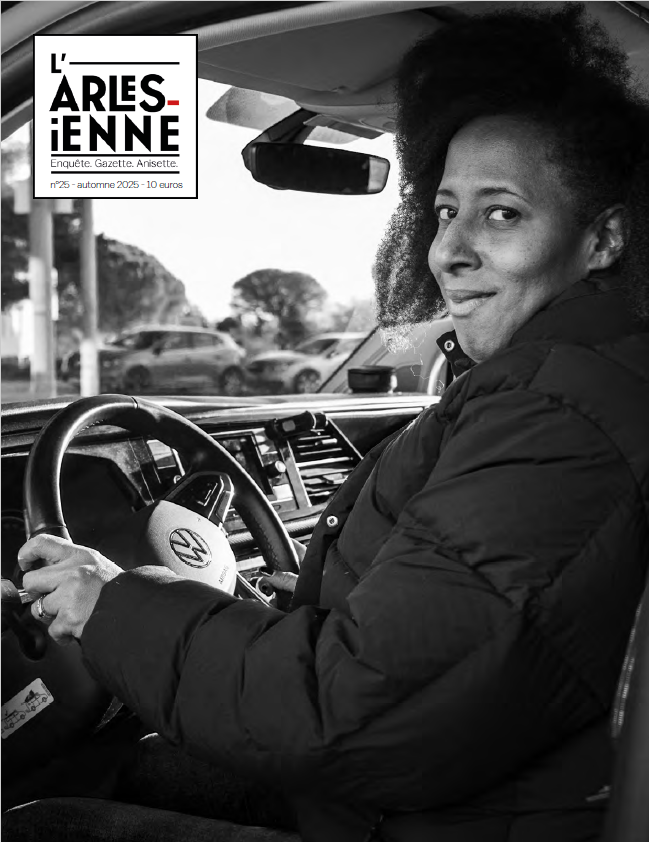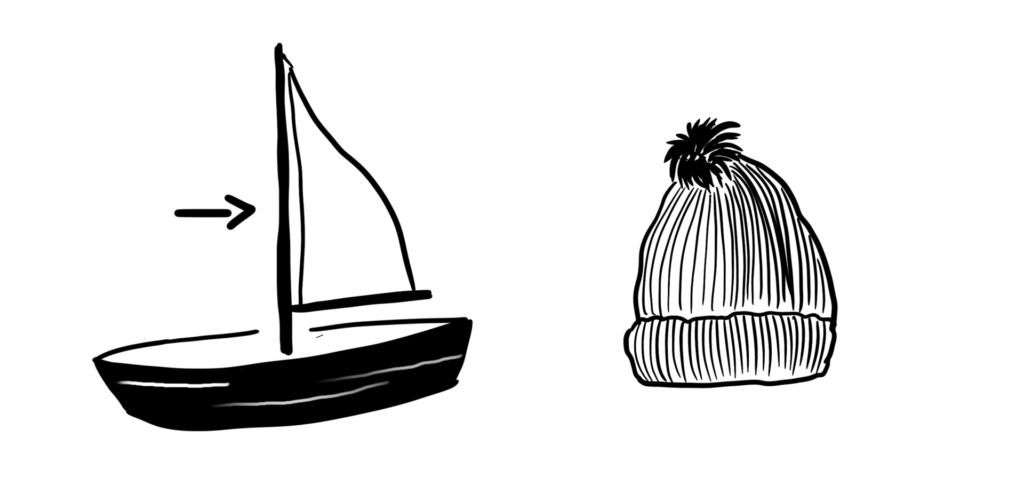Brûlages plastiques en Camargue : la condamnation de Didier Cornille

Le 18 mars dernier, Didier Cornille est reconnu coupable par le tribunal de Tarascon des brûlages de déchets plastiques ayant eu lieu pendant près d’une semaine en février 2024, au nord de la Camargue. Il est condamné à payer 20 200 euros, en amende et indemnisations aux associations environnementales qui ont porté plainte.
En février 2024, des feux de déchets plastiques ont duré pendant plusieurs jours, sur les terres agricoles du grand Mas du Roy. Didier Cornille est reconnu coupable de ces brûlages et le 18 mars le Tribunal de Tarascon le condamne à une amende de 15 000 euros pour “gestion irrégulière de déchets”. L’entreprise impliquée, la SCEA Les Saladines est, elle, condamnée à 50 000 euros d’amende avec sursis. Le salarié ayant procédé aux brûlages, sur ordre de son supérieur, écope lui d’une amende de 4 000 euros avec sursis. Les prévenus sont également condamnés à payer 2 000 euros au titre du préjudice moral et 600 euros pour les frais de justice à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et à France nature environnement 13 (FNE13), soit un total de 5 200 euros. “On demandera ces sommes à Didier Cornille, pas à son salarié” précise Isabelle Vergnoux, l’avocate des parties civiles.

Des fumées s’élèvent au-dessus des terres du Mas du Roy. Les brûlages ont commencé au moins dès le 1er février 2024, date à laquelle l’Arlésienne s’était rendue sur place.
Dans ses réquisitions, le procureur avait demandé pour Didier Cornille non pas une amende mais une peine de quatre mois de prison avec sursis. Pour les Saladines, une amende de 100 000 euros avec sursis. “Ce ne sont pas la société ou le salarié, c’est le dirigeant qui m’intéresse”, précisait-il, “le gérant est le donneur d’ordre et son salarié ne saurait s’exonérer de l’ordre”. Pour Isabelle Vergnoux, “les réquisitions du procureur étaient ambitieuses. Il est dommage que le juge n’ait pas suivi, mais sa décision est tout de même correcte. Elle envoie un signal”. Par l’intermédiaire de son avocat Fabrice Baboin, Didier Cornille nous informe qu’il ne fait pas appel de la décision, car il “ne contestait pas la matérialité de l’infraction” et “vu que les réquisitions ont été substantiellement modérées par le Tribunal”.
Si les feux ont duré pendant près d’une semaine, les faits jugés sont circonscrits aux brûlages ayant eu lieu les 5 et 6 février, dates des procès verbaux établis par la gendarmerie et la police rurale. Appelée par des riverains, c’est d’abord la gendarmerie qui se rend sur place le 5 février. Mais les feux continuent et la police rurale se rend à son tour sur place le lendemain et constate qu’une pelle agricole est en action et pose des déchets plastiques sur un tas en combustion. Elle fait état de quinze tas déjà brûlés et de plusieurs tas de bois et plastique en cours de combustion.

L’usage d’une pelle mécanique donne une idée de la masse de déchets.

L’un des nombreux tas disposés entre deux allées de cyprès. Didier Cornille, via son avocat, conteste l’ampleur des brûlages : “En aucun cas n’ont été brûlées des quantités importantes de plastiques”. Il évoque “quelques dizaines de kilos”.
Des feux pour faire l’économie du recyclage
Didier Cornille est identifié comme l’employeur de l’ouvrier agricole alimentant le feu et il est entendu par la police quelques jours plus tard. Il indique à ce moment-là qu’il a utilisé le plastique dans le but de faire brûler le bois, qui était vert. Un argument réitéré par l’intermédiaire de son avocat : “Les plastiques ont seulement servi à la combustion des arbres fruiticoles morts. (…) Le sujet n’était donc pas le brûlage de plastiques mais celui des vergers du Mas du Roy (brûlage parfaitement légal).” Un brûlage légal qui nécessite néanmoins une demande d’autorisation auprès de la Ville : la demande d’autorisation de brûlage des végétaux a bien été déposée, mais de manière postérieure aux faits. Par ailleurs, le brûlage de plastique, quelle qu’en soit la raison, est illégal. Pour le procureur de la République, Laurent Gumbau, “l’argument de l’utilisation du plastique pour brûler le bois vert est fallacieux. La vraie raison, c’est de faire l’économie de l’utilisation de la filière agréée. Plutôt que de respecter une réglementation destinée à empêcher la pollution, il fait le choix de faire des économies et tire du bénéfice à l’infraction”. Auprès des forces de l’ordre, Didier Cornille expliquait que le plastique est doublement taxé : à l’achat, et au moment du recyclage. Et que la somme à payer pour le recyclage est très élevée. Ainsi, pour des paillages sales, le coût est de 150 à 200€ la tonne. Sur son site internet, Reveny, l’entreprise de maraîchage de Didier Cornille, mentionne 300 hectares de melons et 470 hectares de salade. À raison d’environ 1 tonne par hectare, le coût du recyclage pourrait dépasser les 150 000€. Une somme difficile à mettre en perspective. Didier Cornille n’est pas salarié et il n’a pas été en mesure de fournir le montant de ses revenus lors de l’audience. Reveny produit 34 millions de têtes de salade et 9 000 tonnes de melons par an. Pour le procureur, la contestation par Didier Cornille de cette réglementation pour le recyclage est de l’ordre du débat politique, il ne tient qu’à lui de s’engager dans une démarche politique pour la faire évoluer, et il souligne qu’“il va quand même falloir à un moment donné que le dirigeant se plie à la juridiction”.
Clémentine Morot-Sir
Une plainte au nom de la protection de l’environnement
Face à l’ampleur des feux, la LPO et FNE 13 ont porté plainte. Lors de l’audience, leur avocate Isabelle Vergnoux soulignait : “Didier Cornille, ce n’est pas un petit agriculteur qui n’arrive pas à boucler ses fins de mois. C’est de l’agro-industrie, qui est tentaculaire dans la région, avec 700 hectares en Camargue, plus de 2 800 hectares en tout. Ça lui donne une responsabilité. On peut penser que ce qu’il a fait là, il pourrait le faire sur l’ensemble de ses parcelles : il revendique de ne pas respecter la réglementation. Il a une gestion irrégulière des déchets plastiques depuis des années, il ne s’en cache pas. Ces brûlages, il les fait au détriment de la santé des riverains. Selon eux, ils sont habituels. Mais d’habitude, quand ils appellent les gendarmes, ils ne se déplacent pas. Heureusement, cette fois ils se sont déplacés”. Outre l’impact potentiel en termes de santé publique, les parties civiles dénoncent la pollution engendrée à la fois dans l’air, les sols et l’eau, qui plus est en zone Natura 2000 : “On peut raisonnablement penser que le lessivage des terres va entraîner les déchets toxiques dans le petit Rhône, qui par ailleurs est déjà sujet à la pollution par les pesticides.”
Plasticulture, limites et évolutions
Via son avocat, Didier Cornille souligne également “l’absence de véritable filière de retraitement des déchets plastiques qui ne sont pas recyclés par les entreprises en charge dudit retraitement mais enterrés (ce qui engendre une pollution de long terme)”. Ainsi, les paillages plastiques sales n’avaient pendant longtemps pas de solution de recyclage. En avril 2023, un article de la presse spécialisée soulignait : “ces films ne peuvent être recyclés quand ils arrivent en fin de vie à cause de leur taux de souillure supérieur à 65 %. De ce fait, ils sont envoyés dans des Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour leur enfouissement.”. Néanmoins, une usine dédiée au recyclage de ces paillages a ouvert en 2023 et aurait été à même de recycler les paillages plastiques de Didier Cornille : “la première usine en Europe spécialisée dans le recyclage de ces matériaux a été inaugurée en juin à Vendargues, près de Montpellier, avec le soutien de l’ADEME”, annonçait l’Ademe, l’agence de la transition écologique, dans un communiqué en octobre 2023. “Cette usine, baptisée Plasticlean, a une capacité de traitement de 10 000 tonnes par an et sera donc en mesure de prendre en charge l’intégralité des films en polyéthylène basse densité (PEBD) collectés en France par ADIValor (Agriculteurs, distributeurs industriels pour la valorisation des déchets agricoles, ndlr), l’éco-organisme du secteur des fournitures agricoles.”
Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.
Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !