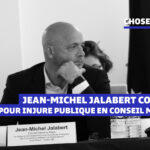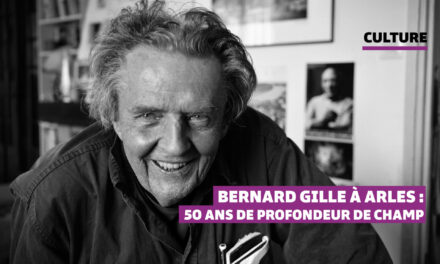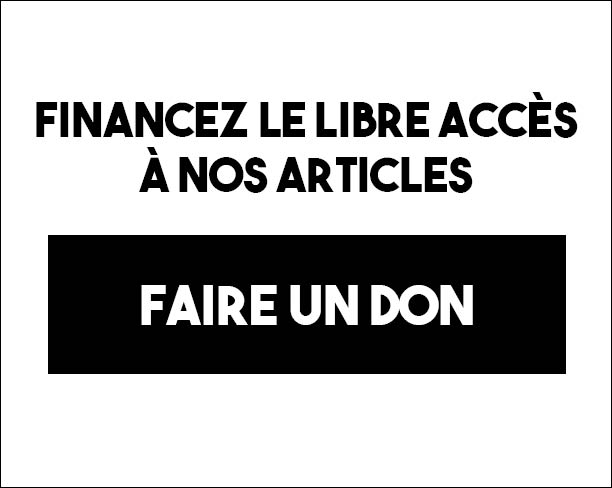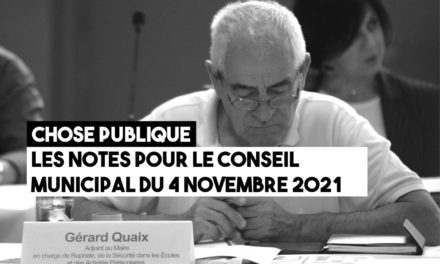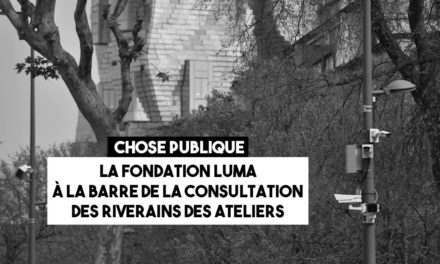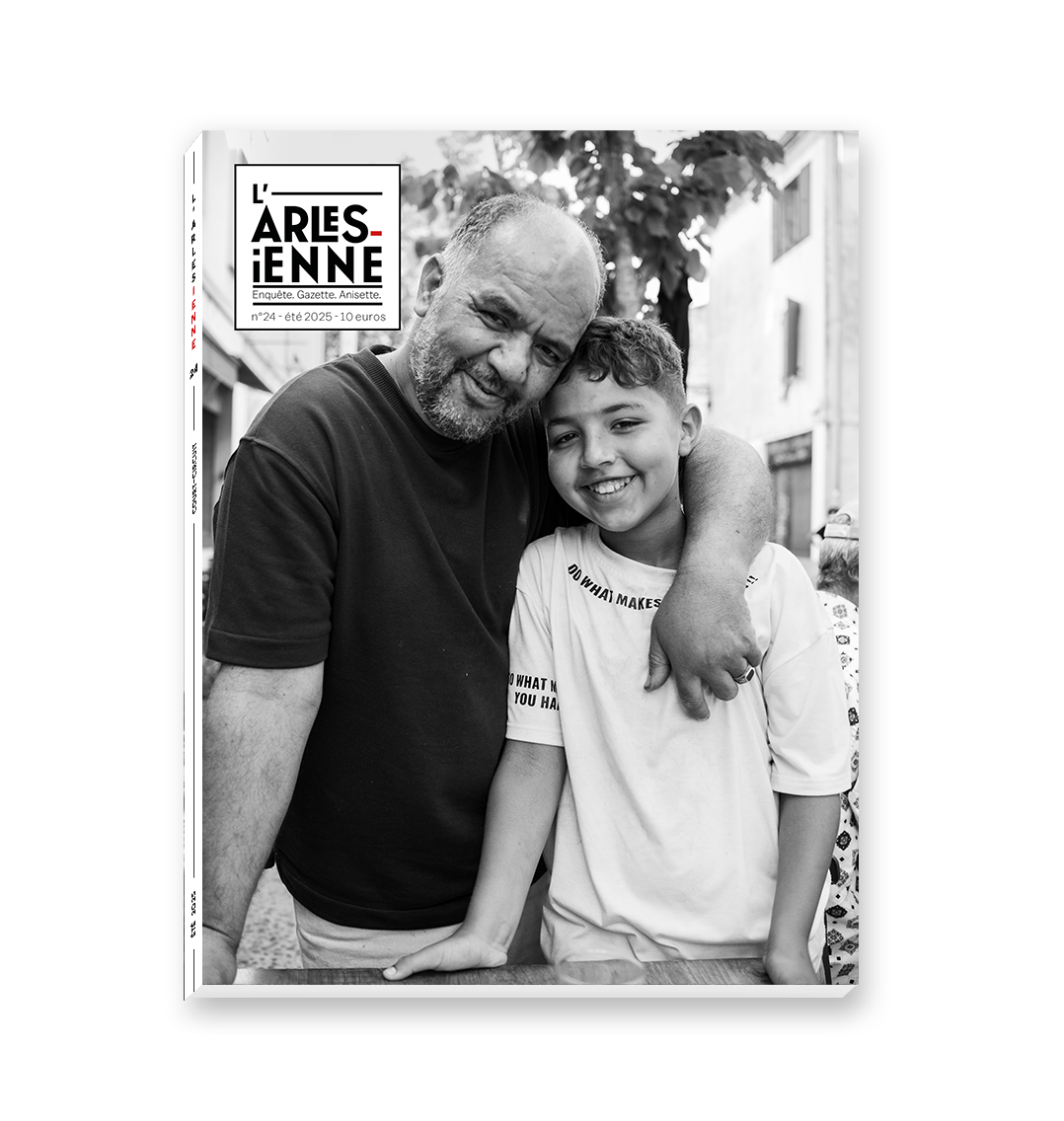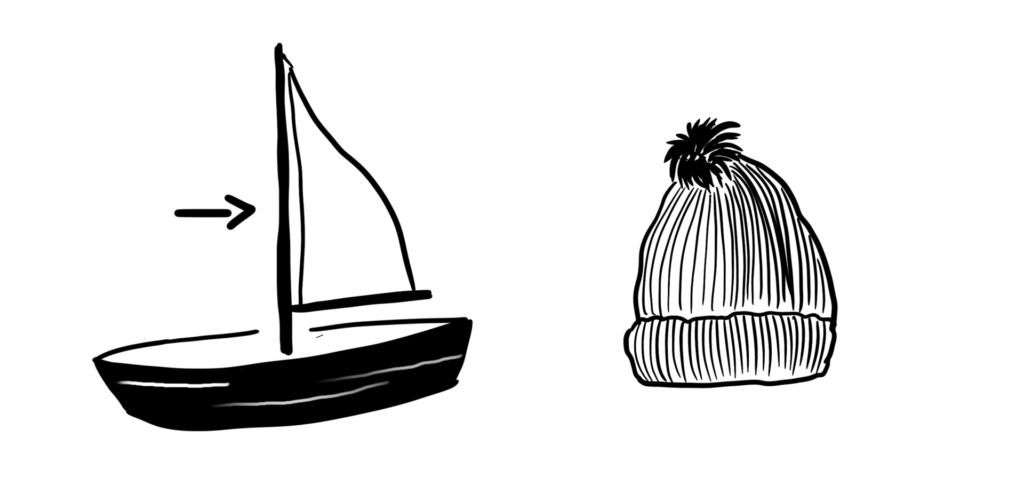Dans l’arrière boutique de l’édifice Capitani-Nyssen

Il est toujours en train de faire des travaux, trouve deux idées à la minute. Jean-Paul Capitani pense vite et parle sans détour, quitte à afficher ses désaccords. A 73 ans, pas question pour lui de prendre sa retraite. Depuis que sa femme Françoise Nyssen est devenue ministre de la culture, il assume la présidence du directoire d’Actes Sud. Entre les maisons d’éditions, les librairies et ses sociétés immobilières, il dirige en tout vingt-quatre entreprises. Solidement implanté dans la ville avec son empire immobilier, il utilise son influence pour dessiner ses projets, avec une méthode bien à lui.

Défiscalisez comme Bernard, soyez mécènes comme Maja et réorientez vos impôts en soutenant l'Arlésienne.
Faire un don défiscalisé à la presse libre, locale et de saison... désormais reconnue d'intérêt général !