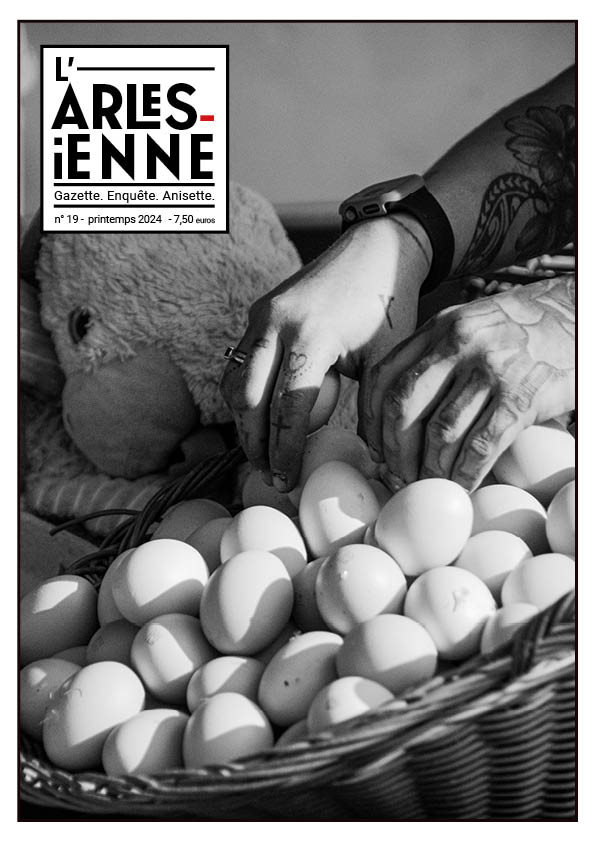Avortement, raconter ce qui se tait

Depuis la loi Veil de 1975 qui l’a légalisée, les conditions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ont été améliorées par le législateur. Dernier progrès en date : la loi du 2 mars 2022 qui permet l’allongement du délai de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines. Le décret est à venir. Sur le papier, tout semble aller pour le mieux. Mais en pratique, tout est compliqué et l’accès à ce droit ne se fait pas sans difficultés et sans souffrances. Comme en témoignent l’expérience vécue par l’auteure de cet article et les récits recueillis auprès d’Arlésiennes.
Une mauvaise expérience personnelle a motivé ce récit. Un avortement, vécu à l’été 2021 à l’hôpital d’Arles. Des mois plus tard, j’ai l’envie de dire ce qui habituellement se tait. De donner la parole à des femmes, des Arlésiennes qui ont vécu une ou plusieurs interruptions volontaires de grossesse (IVG). « Enfin quelqu’un qui va en parler », nous répond rapidement M., suite à l’appel à témoignages de l’Arlésienne diffusé sur les réseaux sociaux. Parler d’avortement reste tabou. Et l’accès à ce droit relève encore d’un parcours de combattante.
Les interlocutrices, avec lesquelles je me suis entretenue en mars 2022, ont quasiment toutes souhaité rester anonymes : par peur d’être reconnues, jugées, mais aussi parce qu’il s’agit d’un sujet intime. Chaque histoire est personnelle, chaque situation est différente. Mais globalement, les mêmes maux reviennent : infantilisation, jugement, manque d’empathie… de la part des professionnels de santé. Sur les huit témoignages recueillis, un seul est positif.
Sur un moteur de recherche : « Avorter à Arles »
Mon histoire commence par deux traits sur un auto-test. Non, je ne suis pas positive au Covid. Je suis enceinte. Les signes étaient là : nausées, fatigue, pouls ralenti. Pourtant, je me croyais prémunie par un faible taux de fertilité, un suivi de mon cycle et la prise de la pilule du lendemain suite à ce rapport non protégé. Mon cas n’est pas orphelin. 72 % des avortements sont pratiqués sur des femmes qui utilisent une contraception, selon l’inspection des affaires sociales(1). Parmi les témoignages que j’ai récoltés, elles étaient au moins quatre à avoir un stérilet ou à prendre la pilule.
Mon choix est affirmé. Je ne veux pas d’enfants, pas avec cette personne, pas maintenant. Reste à savoir comment. Je manque de ressources pour cette « première fois » à 34 ans. Je ne suis pas suivie par un ou une gynécologue. Je n’ai personne dans mon entourage qui soit passé par là… Alors je vais chercher les infos là où on a le réflexe de le faire, sur Google.
Je tape « Avorter à Arles ». Doctolib me propose une sage-femme et un gynécologue, mais pas de rendez-vous possible avant deux mois. J’appelle la sage-femme, répondeur, le secrétariat n’est ouvert que trois jours plus tard. Une éternité ! Je me tourne alors vers l’hôpital d’Arles. Après plusieurs appels dans le vide et un message laissé, le secrétariat finit par me rappeler. J’ai un rendez-vous la semaine suivante pour une échographie de datation du début de la grossesse.
Le temps est long Les quelques jours qui me séparent de cette échographie sont désagréables. A aucun moment je doute de mon choix, mais je suis perturbée. J’essaye de me rassurer, mais je suis en plein inconnu. J’alterne entre recherches sur le sujet et tentatives de penser à autre chose. Impossible. Enfin, vient le jour de l’échographie. C’est la première fois que je mets les pieds à l’hôpital d’Arles. On m’indique la salle d’attente. La gynéco qui doit s’occuper de moi est en salle d’accouchement. Le temps est long.
J’ai le loisir d’analyser toutes les affiches sur « comment bien vivre votre grossesse » et je vois passer quelques ventres ronds. Je lis en détail le document « Information patiente », un A4 qui explique les procédures et la kyrielle de risques de l’IVG. Je commence à m’inquiéter, me dire que quand même j’aurais pu faire « plus attention ». Je pense à partir, mais je n’ai pas vraiment d’autres options.
Trois heures plus tard, la gynéco s’excuse sincèrement. Elle allume la machine de l’échographie, dont l’un des écrans est placé juste devant moi. Je précise que j’aimerais ne pas voir l’image, ni entendre de son. Très respectueusement, elle éteint l’écran, mais elle ne sait pas comment faire pour le son. Après de longues minutes, elle trouve le secours d’une collègue pour y arriver.
Ce choix n’a pas été respecté pour L. « On ne me demande pas si c’est pour un avortement ou non. Je vois le fœtus. La personne est gênée quand elle comprend que c’est pour un avortement », se souvient-elle.
Maltraitance médicale
La semaine suivante, j’ai rendez-vous avec un autre gynécologue. Le médecin est froid, laconique voire méprisant. Et surtout moralisateur, même s’il ne m’interroge pas sur mon choix d’avorter. « La pilule du lendemain ça marche mal, vous ne viendrez pas vous plaindre si vous retombez enceinte », cingle-t-il. Il me fait remplir et signer des papiers. Je suis étonnée, car je dois cocher « j’ai eu un premier rendez-vous » et « on m’a proposé un suivi psychologique », suivi de « je l’ai accepté ou j’ai refusé ». Je l’interpelle sur le fait qu’on ne m’a rien proposé du tout et que c’est mon premier rendez-vous. Il me dit que ce n’est pas grave et m’incite à ne pas trop poser de questions.
Ce qui lui importe, c’est de me prescrire une contraception. Elle est d’ailleurs déjà pré-écrite sur l’ordonnance, avec les antidouleurs prévus pour l’IVG médicamenteuse. Je lui indique que je n’en souhaite pas. Lever de sourcils. Il insiste, il semble avoir tout particulièrement envie de me poser un stérilet. Je lui raconte que dans mon entourage, la majorité ne le supporte pas, a des douleurs. « On entend toujours les témoignages de celles pour qui ça se passe mal, jamais de celles pour qui tout va bien », me rétorque-t-il.
Bien plus tard, une amie a témoigné que ce même médecin lui a posé un stérilet, mais mal. Elle ressentait des douleurs atroces tous les mois. Il a fallu une écho qui montre qu’il était tordu pour que le soignant admette qu’il y avait un problème.
Quant à C., elle est suivie par le même médecin, qu’elle trouve « toujours très froid, peu importe les sujets ». Elle l’a consulté pour une IVG il y a quatre ans. « J’avais 35 ans. Il faut savoir que je prends une pilule, je ne l’oublie jamais, mais parfois elle ne fonctionne pas », se sent-elle obligée de justifier. « Quand je suis allée à l’hôpital, les gens n’étaient pas très aimables. On vient pour avorter, on se sent mal vue. Cette fois, le docteur a vraiment insisté pour savoir si je voulais avorter. J’ai dit oui, car j’avais déjà deux enfants et mon mari un également. »
Parce qu’elle est allergique au stérilet, C. a aussi demandé une ligature des trompes de Fallope. L’acte permet d’empêcher irrémédiablement aux ovules de rejoindre l’utérus et donc d’y être fécondés. « Ils m’ont dit que ce n’était pas avant 40 ans. » Ce qui est faux. Depuis 2001, la loi permet aux femmes majeures de se faire ligaturer, sans restriction d’âge. « Du coup je me coltine un implant dans le bras. J’aurais aimé avoir cette ligature des trompes, car j’ai déjà subi plusieurs avortements », pose amèrement mon interlocutrice.
Doutes et déroute
C. décrit par ailleurs des tentatives de dissuasions lors de ses précédentes démarches d’IVG à Avignon. « Ils vous disent, “il y a des femmes qui n’ont pas d’enfants, qui ne peuvent pas en avoir. » Elle s’est sentie sous pression par sa situation maritale : « Comme j’étais en couple, je n’avais pas le droit [de vouloir avorter]. Il n’y avait pas de raison. Sauf qu’un enfant ce n’est pas qu’un bébé, ça s’élève toute une vie. Je pense qu’on est en droit de choisir si on veut en avoir ou pas. »
B. a également été confrontée à la remise en question de son choix, en 2014. Elle avait 34 ans, déjà maman d’un jeune enfant et sa décision a été prise avec son compagnon. Elle a consulté une infirmière ou une psychologue (elle ne sait plus exactement) de la Protection maternelle infantile (PMI), un service public du département. « Je suis arrivée avec mon choix et je suis repartie avec un doute », raconte-t-elle. « Est-ce que vous n’allez pas le regretter ? », lui aurait répondu la personne de la PMI. Elle lui a parlé du syndrome du deuxième enfant. Tout en ajoutant « mais vous avez fait votre choix, vous voulez le garder ». B. est ressortie bouleversée, mais a confirmé son choix.
En revanche, Marion s’est sentie très bien prise en charge par la PMI, avec professionnalisme et gentillesse. « Dans ma situation de détresse totale, j’ai compris la préciosité d’être « prise en charge » psychologiquement par une personne sans jugement et à l’écoute bienveillante », témoigne Marion, qui avait 29 ans à ce moment-là. Elle a aussi été rassurée au cours de ce rendez-vous, « sur le fait qu’il n’y avait pas de danger notable de procéder à une intervention chirurgicale pour une femme n’ayant jamais eu d’enfant [risque de stérilité, etc.] contrairement à ce qu’avait pu me dire le tout premier médecin que j’avais contacté ».
Mais elle s’est ensuite sentie humiliée lors de la préparation de l’intervention. Elle a consulté une gynécologue en ville. La même qui l’a ensuite opérée à la clinique Jeanne d’Arc. « Elle m’a largement infantilisée en m’exposant les différents moyens de contraception. Ce n’était clairement pas le discours que j’avais besoin d’entendre au vu de ma détresse et du sentiment de culpabilité relatif à ce que j’étais en train de traverser. Je me souviens de sa posture et de son discours moralisateur qui ont fini par m’anéantir. Je me suis écrasée et je suis ressortie du cabinet avec une ordonnance pour prescription de pilule. » Marion ressent aujourd’hui de la colère à propos de cet épisode.
Vous avorterez dans la douleur
Pour ma part, l’IVG s’est faite par voie médicamenteuse. Les délais le permettaient. J’ai pris un médicament le jour de la consultation et un second à domicile 48 heures plus tard, provoquant des contractions utérines pour expulser l’embryon. J’avais peur de la douleur ainsi que de mon état émotionnel et physique. Je devais aller travailler le lendemain, alors je demande au médecin de l’hôpital s’il est possible d’obtenir un arrêt de travail. Réponse sans appel du praticien, « personne ne demande ça. Il n’y a pas de raisons que ça se passe mal ». Décidément, à aucun moment, je ne me suis sentie écoutée et rassurée dans cet hôpital. Heureusement pour moi, tout s’est « bien passé » physiquement. Les antidouleurs ont fait leur effet. L’expulsion a eu lieu dans les toilettes sans que j’ai à voir ce qui était sorti.
D’autres expériences ont été moins « réjouissantes ». Pour avorter à la maison, M. a consulté un gynéco libéral qui lui a donné les cachets mais très peu d’indications. « À ce stade, je ne comprends toujours pas que l’on ne m’ait prescrit aucun antidouleur », explique-t-elle. « Et là de longues heures se passent et je n’irai pas dans les détails de la souffrance absolue que j’ai subie. Je n’ai jamais ressenti de telles douleurs et j’ai sincèrement cru que je n’allais pas y arriver », narre-t-elle.
J. est, quant à elle, restée une journée à l’hôpital d’Arles, « un jour férié. Il n’y a pas beaucoup de personnel. Il n’y a même pas de gynécologue ou du moins pas disponible durant mon séjour. L’aile destinée aux soins gynécologiques est saturée, on m’installe donc dans une chambre de l’aile maternité. De ma chambre, j’entends des familles heureuses rendre visite aux jeunes mamans et des nourrissons pleurer. Une grande après-midi de solitude démarre pour moi », se remémore-t-elle. L’infirmière lui administre le médicament qui va déclencher l’avortement, associé à du paracétamol pour calmer les douleurs à venir. Son calvaire commence 20 minutes plus tard : « J’ai des nausées terribles et ne cesse de vomir. J’appelle quelqu’un en vain. Elles sont toutes débordées. » Une infirmière finira par lui expliquer que ses cachets ont été surdosés. « Mes nausées s’amplifient jusqu’à l’évanouissement, je tremble de la tête aux pieds. J’arrive à atteindre le cabinet de toilette de la chambre. Je perds beaucoup de sang et m’évanouis à nouveau. Je reste seule et sens que « ça » se termine. Je vois le fœtus dans la cuvette des toilettes », décrit J.. Elle dit avoir eu une hémorragie permanente « qui [l’a] mise K.O. » pendant quinze jours après son passage à l’hôpital.
Désolé c’est le protocole
Il y a dix ans, le médecin de Delphine l’a envoyée à la clinique Urbain V d’Avignon, elle avait 26 ans. C’était pour un avortement thérapeutique à plus de trois mois de grossesse. Avant l’opération, ils l’ont laissée sur la table avec la porte ouverte, « face à une nana en train d’accoucher ». Et les premiers mots dont elle se souvient en salle de réveil sont, « il n’y a rien de plus beau dans la vie d’une femme que d’avoir un enfant ». Delphine décrit que ça l’a profondément choquée. « Je ne voulais pas avorter, j’avais un bébé qui avait mal grandi pour x raisons », explique-t-elle.
Après avoir expliqué la violence psychologique que ce fut pour elle, le médecin lui aurait répondu que cela faisait partie du protocole, « pour responsabiliser les jeunes femmes, pour qu’elles comprennent que l’avortement n’est pas un acte de contraception ». Sidération de Delphine : « J’ai trouvé ça… je n’ai même pas les mots… violent, patriarcal. Ils m’ont dit « ah oui c’est dommage, c’était thérapeutique, désolés on a mal lu votre dossier ». »
Avorter reste encore une épreuve pour les femmes qui y ont recours, par choix ou non, de gaieté de cœur ou non. Les besoins spécifiques de ces femmes et de moi-même n’ont pas été assez pris en compte par les hôpitaux et les gynécologues.
Une voie de salut semble venir du côté des sages-femmes. Parmi les témoignages reçus, celui de P. apporte de l’espoir. Elle est tombée enceinte durant le premier confinement et avait peur que les structures soient fermées. Ironie de la situation, elle a trouvé une « vraie chaîne de soutien informelle ». Elle remercie encore aujourd’hui la pharmacienne, puis l’infirmière et enfin la sage-femme qui l’ont accompagnée dans cette période où elle craignait que l’IVG ne soit pas considérée comme « essentielle ». Aussi, elle recommande de consulter des sages-femmes. Depuis 2016, celles-ci sont habilitées à pratiquer l’IVG médicamenteuse. Gageons qu’elles s’engagent dans une approche moins médicalisée et plus à l’écoute de leurs patientes.
Norma Pastor
1. « Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 », octobre 2009.

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.