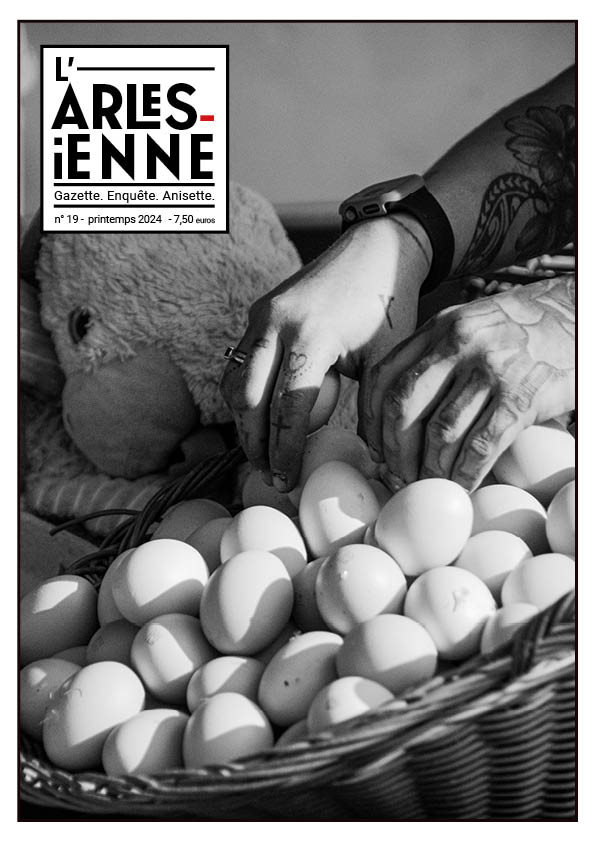Beaucaire, centro del pueblo


Travailleurs la semaine, le week-end, ils reproduisent une “cancha” un lieu de convivialité autour d’un terrain de sport, comme en Equateur. Ph. EB
Tous les samedis et dimanches après-midi, les Latinos se réunissent autour du terrain de volley qu’ils ont aménagé à Beaucaire. Un moment de détente en communauté avant de retourner travailler dans les champs toute la semaine. On joue, on discute, on parle aussi. Avec l’espoir qu’un jour, le sort de la communauté s’améliore.
A côté des arènes de Beaucaire, le grand espace en terre a des airs de place du village. Une assemblée se masse autour des terrains de volley. Sur le parking, le coffre ouvert d’une voiture lance des rythmes latinos. Au moins 250 Sud-Américains sont là. Femmes, enfants et majoritairement des hommes. La plupart sont équatoriens, mais il y a aussi des Boliviens, des Colombiens, des Péruviens, des Honduriens et même quelques Argentins. En fait, ce qu’il se passe à Beaucaire, c’est tout simplement un petit bout d’Équateur qui s’est délocalisé. « Chez nous, c ‘est la coutume. Quand on a fini de travailler, on se rejoint pour se détendre un peu, faire un match avant de rentrer chez soi », explique Humberto Gualan, 47 ans, qui semble avoir un sourire permanent accroché au visage. Aux champs la semaine et organisateur le week-end, c’est lui qui a acheté les filets et les ballons. A chaque fois, c’est lui qui arrive en avance pour tout installer.
Si dans leur pays d’origine, “la cancha” c’est tous les jours, ici, les réunions ne se déroulent que les week-ends. La faute à l’éloignement et au rythme de travail. La communauté est éparpillée entre Beaucaire, Avignon, Châteaurenard, Maillane, Graveson, la Camargue… Humberto a eu l’idée d’organiser ces rassemblements, « il y a six ou sept ans » quand les « Latinos » commençaient à être nombreux sur le secteur, alors que les entreprises d’intérim espagnoles envoyaient en masse la main-d’œuvre aux agriculteurs locaux. Le but : réunir la communauté pour passer des moments « de allegria, sourit Humberto. Toute la semaine, c ‘est dur. Ici, c ‘est notre seul moment pour être relax. »

Humberto, l’organisateur de la “cancha”, c’est lui qui installe les filets en début d’après midi.
Viviana, originaire de Bolivie, rejoint la conversation. Comme beaucoup, elle regrette que les tournois soient organisés « clandestinement ». Elle rêve d’une association pour faire « ça dans les règles » et que la mairie leur mette à disposition « un petit local avec des toilettes ». Humberto explique qu’ils sont « tolérés » et que la police a expliqué qu’ils pouvaient rester jusqu’à 19 h l’hiver et 21 h l’été. Mais visiblement, le rapport n’est pas facile avec la municipalité de Julien Sanchez (FN). Pourtant, « poco a poco, on va réussir à s’organiser », croit Humberto qui parle de créer une association sans connaître vraiment la démarche à suivre.
Des ballons plus durs, des conditions plus rudes
Le tournoi bat son plein et c’est le terrain des meilleurs joueurs qui attire le plus de spectateurs. Les visages sont concentrés, l’arbitre compte les points. Le jeu est un peu différent du volley. « C ‘est l ‘Ecuavoley, précise Angel Merina, maçon de 35 ans. Le ballon est plus dur parce qu’en sortant du travail, comme on est plein de force, il nous faut un ballon lourd. Si on prend un ballon de volley normal, il s’envole. » Au volley comme au travail, « les patrons nous prennent parce qu’on est dur à la tâche », sait Angel.
Comme presque tout le monde ici, Angel est parti à l’aventure en Europe pour fuir le manque de travail et la pauvreté de son pays. Arrivé à 20 ans en Espagne, la crise économique le pousse à repartir pour la France en 2011, huit ans plus tard. « D’autres sont partis en Allemagne, en Angleterre ou en Suisse », raconte t-il. Lui a la chance de bien parler français, d’avoir une intégration facile et de ne pas travailler dans les champs comme la plupart.
Ces matches de volley servent à prendre des nouvelles des amis et organiser la solidarité en cas de coups durs. Maria Gualan, 18 ans, est la fille d’Humberto, l’organisateur. Elle se rappelle avoir créer une collecte de fonds, il y a quelques années. Il s’agissait de soigner les reins d’une femme de la communauté, laissée à l’abandon par son employeur, sans carte vitale. La jeune fille sert aussi d’interprète quand la police vient faire une ronde ou quand l’Inspection du travail vient mener son enquête sur Terra Fecundis, une agence d’intérim espagnole qui envoie de la main-d’œuvre dans les champs.

Maria, 18 ans parle très bien le français et sert d’interprète pour la communauté.
Ici, on échange aussi sur les conditions de travail. La mort d’un des leurs revient vite à la surface. En juillet 2011, un employé de Terra Fecundis succombe de déshydratation au Domaine des Sources à Maillane. Depuis, la justice traîne à définir les responsabilités. Viviana, la Bolivienne, décline les pratiques des employeurs trop sévères : « Pour certains, il faut toujours rester penché à cueillir, si on se relève en dehors de la pause, on est viré ! », s’indigne t-elle.
Entreprendre pour stopper l’exploitation
Peters Merizalde, 41 ans, vient de finir sa partie de volley. Il est un précurseur ici. C’est certainement le seul patron de la communauté. Lassé de se faire « voler » par « les entreprises espagnoles qui ne payent pas les heures supplémentaires, qui font des retenues sur les salaires », il commence à travailler en direct avec les agriculteurs comme de plus en plus de Latinos. « Comme je parle bien français, à force, je connaissais les employeurs et ils faisaient directement appel à moi. Un jour, une cliente m’a dit : “mais pourquoi tu ne montes pas ton entreprise ?” » C’est chose faite depuis décembre. En ce moment, il travaille sur de la tomate à Moulès et de la vigne à Roquemaure, au nord d’Avignon. Et il constitue ses équipes en embauchant ses anciens collègues « exploités » par Terra Fecundis. « Chez moi, tout est carré : j’ai une secrétaire et un expert comptable français pour m’aider parce que c’est dur, je ne connais pas tous les normatives (sic). » Il remarque que « de moins en moins d’agriculteurs veulent travailler avec Terra Fecundis à cause de l ‘Inspection du travail et de leurs visites. »

Peters, 41 ans a créé son entreprise pour arrêter de travailler pour terra Fecundis, une entreprise avec laquelle il ne garde pas de bons souvenirs.
La nuit tombe et les gens commencent à quitter le terrain. Dans la rue principale de Beaucaire, une toute petite épicerie « productos latinos » a ouvert il y a quatre ans. German Abad, originaire d’Équateur, est fier d’être le tenancier de la première épicerie « declarada », tout à fait légale, même s’il a éprouvé maintes difficultés pour le faire. Lui aussi dit avoir des rapports compliqués avec la mairie. Il dit s’être fait refuser « l ‘autorisation pour ouvrir un restaurant ». Pas le temps de discuter plus, c’est dimanche et ses deux filles de 9 et 12 ans l’accaparent. D’ailleurs, il voit « leur avenir ici en France » et espère la meilleure éducation possible.
Quelques mètres plus loin dans la même rue, l’Euro Market, l’épicerie tenue par Driss affiche des petites annonces en espagnol : « Recherche logement », « Recherche lit. » À l’intérieur, de la farine de maïs et autres produits d’Amérique du Sud occupent les étals. « On a fait des pizzas, puis du couscous et maintenant, on s’adapte ! », philosophe-t-il.
Eric Besatti

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.






















![[Agenda démocratique] Du 3 au 9 février 2020](https://larlesienne.info/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-démocratique-février-440x264.jpg)