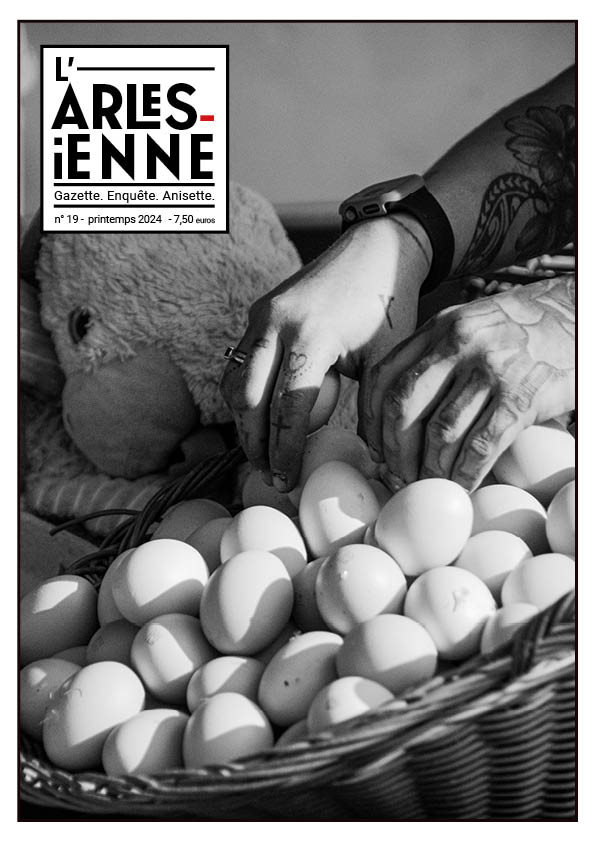L’art pour changer le monde, pas ceux qui le dominent

Les Luma days, le désormais traditionnel rendez-vous de réflexion librement encadré par la fondation, avaient cette année pour sujet « l’interdépendance ». Un thème d’actualité à l’heure où la planète hurle sous les assauts d’un mode de vie devenu insoutenable. La politique, la science, tout le monde se casse les dents sur le sujet. Heureusement, chez les Hoffmann, on a la solution : l’art. Article publié dans le numéro 6 de l’Arlésienne.
Un clic sur votre téléphone et votre commande Amazon traverse les océans en cargo, polluant l’air, la mer et le fond des océans. Voilà ce qu’on peut apprendre assis confortablement sur les chaises des Luma days à écouter l’artiste islandais Olafur Eliasson. Effectivement, « il ne reste plus que onze ans pour agir avant d’entrer dans un système de perturbation irréversible et incontrôlable » comme nous le rappellera quelques heures plus tard le philosophe Bernard Stiegler – autre invité prestigieux. Le monde part en quenouille et les hauts murs blancs de l’Atelier des Mécaniques ne s’en rendent même pas compte. Et quand bien même, que diraient-ils ?
L’art, une solution en araméen ?
Malgré un alarmant constat, nous ne faisons rien. Pour André Hoffmann, frère de Maja Hoffmann, la raison est évidente : crise de confiance (des politiques, des journalistes, des scientifiques). La solution est tout aussi évidente : l’art. André Hoffmann l’assure : « La culture, les gens ont encore confiance en elle. »
Si l’art est une voie d’accès, est-il accessible pour autant ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre Guillaume Maraud, en résidence d’artiste organisée par Margaux Bonopéra, descendu spécialement de Paris pour analyser de près les Luma days. Artiste et critique du milieu dans lequel il évolue, Guillaume Maraud appréhende le monde de l’art comme un lieu autoritaire et excluant.
Pour lui, la forme-même des institutions culturelles et artistiques – avec leurs expositions et leurs restitutions – répond à un format socio-culturel qui a été construit, avec ses croyances et ses médiums dominants, comme la peinture ou la sculpture. « Concrètement, ça fait 200 ans qu’on se pose les mêmes questions : dans un »white cube » est-ce qu’on laisse l’objet au mur ? Est-ce qu’on le pose sur le sol ? Qu’est-ce qu’il y a de subversif dans cet espace de la création ? C’est quand même pas fou. On est quand même censé tout réinventer ici. »
Il convoque Bourdieu : « Je crois qu’une fonction du musée c’est précisément d’être quelque chose où tout le monde peut aller mais où seuls quelques-uns vont. Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il permet de se distinguer de ceux qui n’y vont pas .» Ce que regrette Guillaume Maraud, c’est qu’il n’y ait pas de remise en question plus profonde. « Quel que soit le niveau d’accès, il y a des pratiques, des rites culturels et des habitus sociaux qui font que symboliquement c’est pas évident de se retrouver dans ces espaces et de performer l’amour de l’art. Rendre cette pratique très difficile est bien une manière de se distinguer de ceux qui n’ont pas ces habitus-là. Et de perpétuer des rapports de domination culturelle. » Pour l’artiste en résidence, on se sert de l’excuse de l’art pour exclure encore d’avantage. À travers un langage et un art hermétiques présentés dans des lieux qui le sont tout autant.
Du neuf avec de l’ancien
Pour Guillaume Maraud, l’intentionnalité du projet de Luma apparaît avec des choix artistiques criant de conservatisme. Ainsi, même si l’on n’oublie pas que le directeur artistique du « Core Group » de la Fondation, Hans Ulrich Obrist, a organisé ses premières expositions dans sa cuisine, on n’oublie pas non plus que c’était dans les années 1990. Et que, depuis, il domine le monde de l’art contemporain. Plus évident encore, le choix de Gilbert et George ne peut que questionner. Pour Mustapha Bouhayati, ce sont des provocateurs : « Ils ont commencé à travailler dans les années 1970, en couple, alors que l’homosexualité était punie pénalement jusque dans les années 1980. Ils ont été dans la prise de risque. Le travail qu’ils faisaient de prendre des photos de la reine, de prendre le drapeau, l’Union Jack. Je veux dire c’est pas des vieux schnocks, hein. » Certes, c’était des précurseurs, il y a 50 ans. Les artistes les plus académiques ont souvent commencé par être subversifs. Aujourd’hui Gilbert et George sont très cotés. On ne peut légitimement pas parler de prise de risque en les présentant ici, à Arles.
Le programme Empathie Régénérative est une autre illustration de cette façon de faire du neuf avec du vieux. Réalisé par la Harvard school of design, le projet consiste – entre autres – à créer des cartes qui alimenteront un atlas à partir de dessins de nature esthétiques à visée symbolique et informative. Ainsi, une carte représentera l’état de la flore en Camargue, une autre celle de l’élevage, etc. En combinant six cartes, une solution aux problèmes agricoles de la Camargue se révèle : une ferme fonctionnant selon les principes de l’agriculture régénérative. C’est-à-dire une agriculture globale permettant à d’heureux moutons de paître dans une herbe grasse nourrie à leur propre déjection. Ce qu’on appelait autrefois du crottin. Il s’agit donc peu ou prou de revenir à cette agriculture traditionnelle qui dominait avant la révolution verte promue par le capitalisme. Pour citer un élu présent, on a l’impression qu’« ils réinventent l’eau chaude ».
Réinventer l’eau chaude ? Peut-être, mais pas que. Ainsi, à sa façon, Olafur Eliasson tente de changer le monde en mêlant art, sciences et techniques. Pour lui, une œuvre d’art « écoute et traduit nos émotions ». La mise en pratique concrète des théories évoquées durant les Luma days s’appelle Little Sun. Sa création est jaune, joyeuse et très design. Ce « Petit Soleil » permet ainsi d’éclairer une famille pendant une semaine avec 40 millilitres d’huile. Et d’éviter qu’ils s’empoisonnent avec des lampes à pétrole coûteuses en énergie fossile. Mais est-ce encore une œuvre d’art ou simplement une innovation technologique et design ?
Une prise de conscience globale qui oblige à l’action
L’autre problème soulevé est celui de l’origine des fonds. Pour Guillaume Maraud, encore, « cette manne provient d’une industrie ravageuse. Il s’agit d’un processus d’art-washing effectué avec une industrie loin d’être clean .» André Hoffmann, héritier et vice-président des laboratoires Hoffmann-Laroche, le reconnaît d’ailleurs d’emblée, sidérant une assemblée libéralo-compatible : « Oui, l’entreprise a détruit la planète. » À 14h30, en pleine digestion, ça passe pas pour tout le monde. Il rassure néanmoins rapidement son auditoire : « Elle l’a détruite… Mais elle la réparera ! » De la part d’un dirigeant d’une entreprise particulièrement polluante, ça étonne. Alors, pour nous convaincre, André Hoffmann sort l’argument massue : « Je ne bois pas du sang de bébé tous les matins. » On peut être pour la mondialisation et contre la globalisation, comme l’expliquaient quelques heures plus tôt Bernard Stiegler et Philippe Parreno : « La globalité, c’est la destruction des mondes. […] La mondialisation, elle, intègre les différentes localités. »
Puisque la mondialisation n’est plus un problème, et que la croissance en est le moteur, alors la croissance n’est plus un problème. André Hoffmann en remet une couche : « La croissance a sorti des millions de gens de la pauvreté sur la planète. » Si la croissance n’est pas le problème, d’où vient-il alors ? « De Milton Friedman… » (économiste néo-libéral). Non, l’élégante personne qui assène cette vérité n’est pas Naomi Klein mais Katell Le Goulven, ancienne cadre dirigeante de l’Unicef et actuelle directrice exécutive de la Hoffmann global institute business and society (Insead). « Pendant des années, on a appris aux futurs dirigeants et managers de grands groupes à gérer l’entreprise selon l’unique critère du profit. À l’Insead, on leur apprend à penser également en terme d’environnement et de social. » Cette fois, c’est sûr, l’entrisme bolchévique a achevé son travail de sape de l’ultra-libéralisme.
Les l’Huma Days?
Cette captation du discours humaniste par l’élite financière répond à une logique de globalisation du monde. On accapare le discours de l’autre comme on a accaparé ses richesses. Comme l’explique Dan Borelli, professeur de Harvard : « Pour qu’une action soit menée de façon globale, il est nécessaire qu’un groupe primaire s’en empare, qu’il l’intériorise. » L’élite a dominé l’ancien monde. Si un changement de paradigme s’impose, quitte à contredire 200 ans de pensée libérale, on s’adaptera. Le tout étant de garder la main sur les grandes orientations.
Domination culturelle avec un art contemporain peu accessible, domination financière et domination philosophique, le futur est mort, vive le passé. Il serait vain et très probablement faux de voir, dans cette nouvelle attitude des élites, uniquement une stratégie de communication. La prise de conscience est réelle. À la question posée à André Hoffmann par l’Arlésienne de savoir si cette façon de voir le monde est devenue la norme chez les grands dirigeants, le vice-président des laboratoires répond : « Il y a 25 ans, j’étais un ovni. Quand j’ai pris la tête de l’entreprise et que j’ai commencé à parler écologie, on m’a répondu « oui, oui », pour me faire plaisir, et que je retourne m’occuper de mes oiseaux. Mais depuis dix ans, la conscience de la situation est réelle. »
Dans la famille « Changement-de-Paradigme », on demande la sœur : à l’heure où 50 % de la Silicon Valley s’achète des îles désertes ou se réfugie en Nouvelle-Zélande, Maja Hoffmann, elle, parle d’archipels. Des îles, oui, mais des îles connectées (et pourquoi pas interconnectées). Si tout le monde a conscience qu’on file droit dans le mur, pourquoi ne rien changer tout de suite ? Pourquoi ne pas effectuer, à l’image de notre planète, une révolution ? La réponse viendra lors de la toute dernière intervention des Luma days. Interrogé à propos de son ouvrage Les Diplomates : Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Baptise Morizot explique qu’il est nécessaire de trouver une voix pour faire entendre celle des autres. « La figure du diplomate s’impose. Celui-ci est chargé de donner une voix aux interdépendances. […] Si le diplomate vient bien de quelque part, il défend les deux camps avec la même justesse. La pratique de la diplomatie oblige à s’intéresser aux faits et non aux identités. »
Les artistes sont des diplomates. Tout comme la famille Hoffmann. Luc Hoffmann, le père, disait : « Je suis un négociateur, pas un révolutionnaire ».
Avec leur ADN philosophico-politique hérité de l’ancien régime, les Hoffmann et leurs pairs ne peuvent penser le mot révolution avec une autre image que celle de 1793. Chantres auto-désignés du nouveau monde, c’est donc avec les méthodes du diplomate qu’ils comptent aiguiller le changement de paradigme. En artistes. Espérons juste que le temps qu’ils trouvent leur pinceau, il reste encore un bout de nature à peindre, et que leur œuvre ne soit pas faite de sang, carmin auquel l’ancien monde a eu trop souvent recours pour assurer le sauvetage d’un écosystème – à leurs yeux – plus cher que tous les autres : celui de leur environnement social.
Julien Sauveur

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.